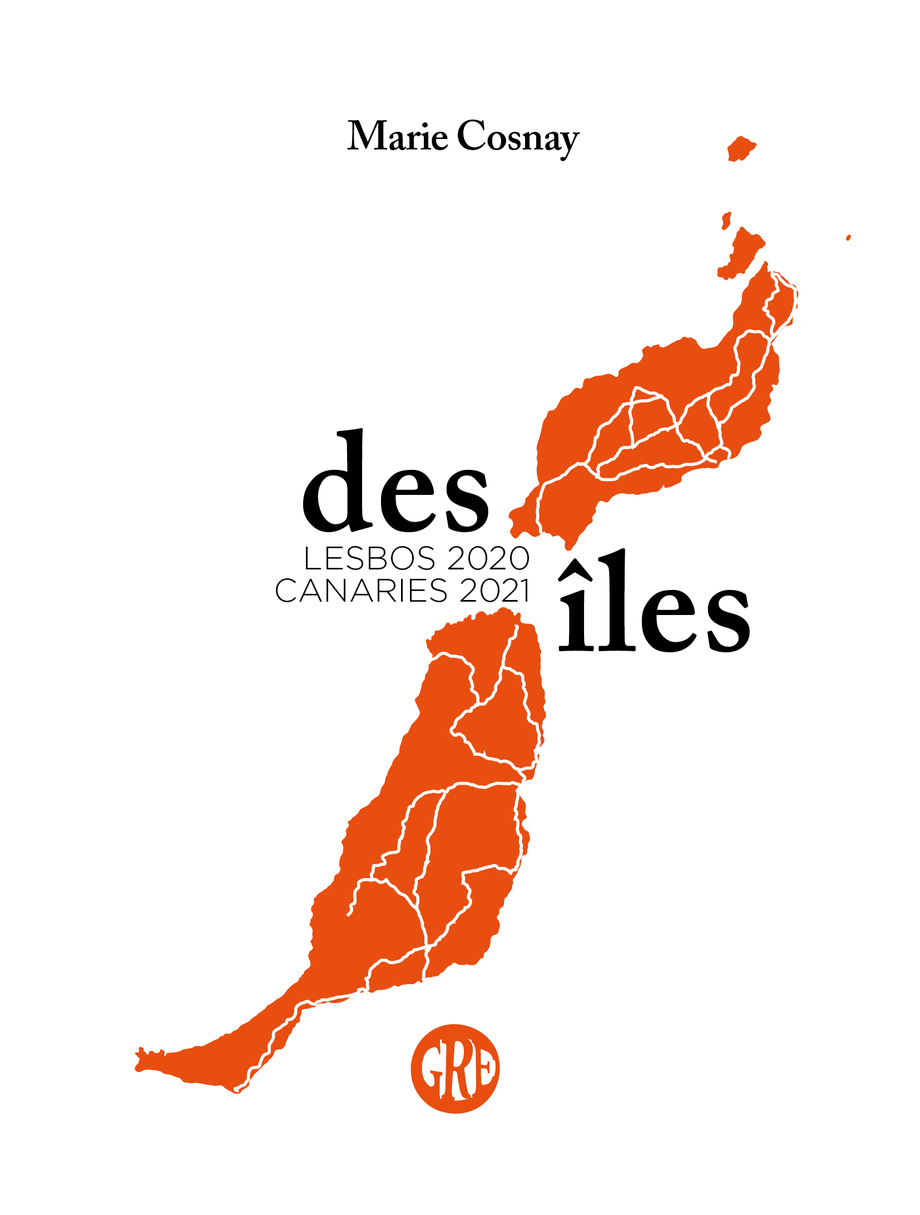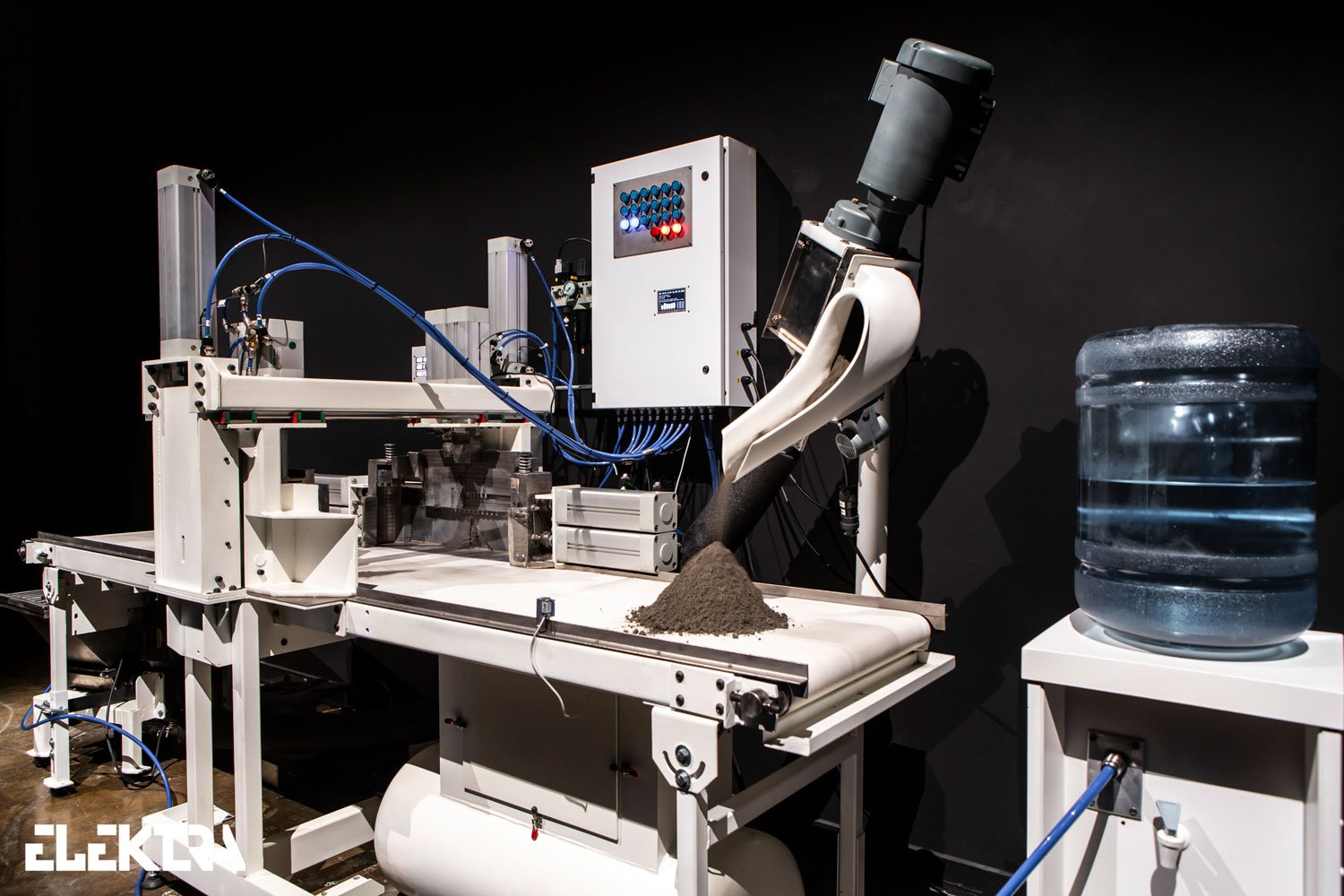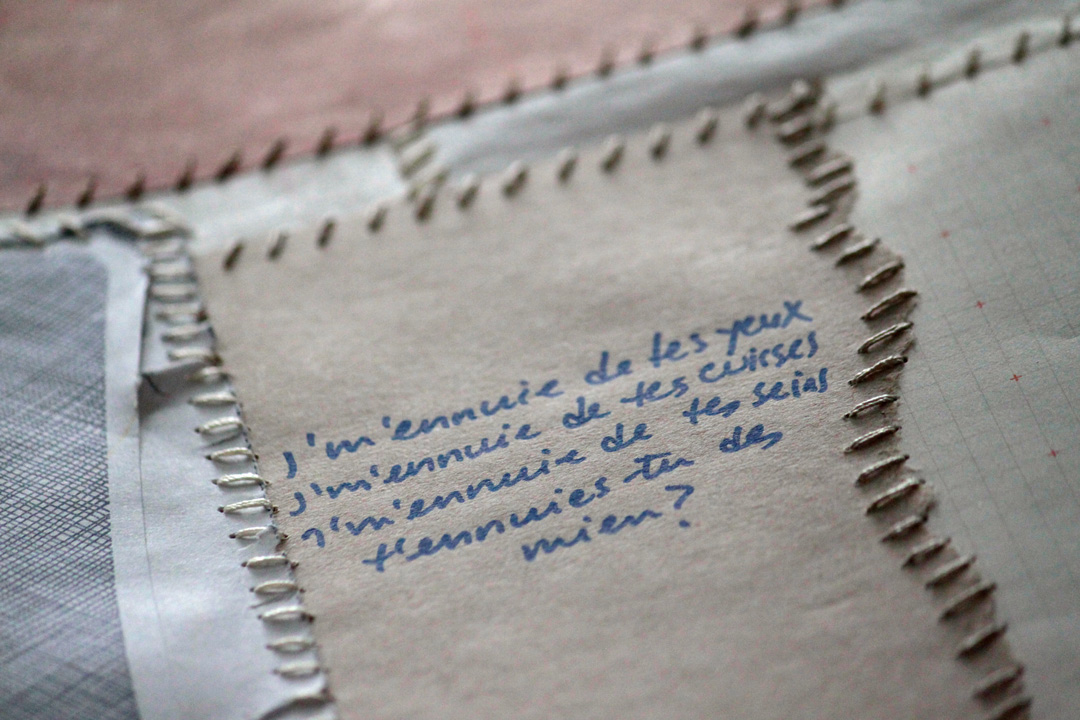Écrivaine prolifique, Marie Cosnay a signé plus d’une quinzaine de récits et une traduction, déjà incontournable, des Métamorphoses d’Ovide (L’Ogre, 2017). Depuis plusieurs années, elle se consacre à l’accueil des personnes migrantes, un travail militant qu’elle accompagne d’une activité éditoriale soutenue. Après Entre chagrin et néant : audiences d’étrangers (éd. Laurence Teper, 2009), Comment on expulse : responsabilités en miettes (éd. du Croquant, 2011) et Voir venir, cosigné avec le philosophie Mathieu Potte-Bonneville (Stock, 2019), elle publie Des Îles (L’Ogre, 2021), premier opus d’une série visant à documenter le parcours migratoire d’hommes et de femmes en quête d’Europe. Écrivant sur le fil et avec une urgence du mot juste, Marie Cosnay offre à lire des récits tissés serrés, avec un souci du plus petit détail, seul garant des plus grandes vérités, les moins évidentes à débusquer. Elle esquisse ainsi les contours d’une éthique de l’engagement littéraire qui résiste à l’obsession esthétique et au plaisir de la fiction. Depuis son Pays basque natal, Marie Cosnay nous invite à sa fabrique poétique et politique.
///
Khalil Khalsi : L’une des premières choses qui frappe à la lecture de Des Îles, ce sont les figures féminines de la migration, plus nombreuses que ce qu’on peut voir ailleurs — dans les documentaires, les médias ou la fiction —, et même représentées différemment : ce sont souvent des femmes très affirmées. Tes enquêtes chercheraient-elles à pallier une forme de misogynie discursive ?
Marie Cosnay : Le parcours migratoire des femmes peut être particulièrement violent, on le sait
/01
/01
Voir le livre de Camille Schmoll Les Damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée (Paris, La Découverte, 2020), à travers notamment la recension qu’en propose Catherine Mazauric dans le n˚277 de Spirale.
. Mais le discours dominant présentant les femmes comme des victimes absolues cache lui aussi une forme de misogynie. Des signes prouvent qu’il y a une très grande capacité des femmes — je ne parle que de celles que je rencontre, d’Afrique de l’Ouest — à organiser leur exil, à choisir elles-mêmes les outils de leur émancipation, même si ce sont des choix très durs à faire. Il s’agit de stratégies visant à atteindre la vie choisie. Les femmes qui arrivent ici, à Bayonne, ont de jeunes enfants ou sont enceintes. Leur situation peut, dans les cas les plus heureux, en province du moins, les aider à être protégées avant leur demande d’asile, dans des structures prévues à cet effet. Leur compagnon, père de leur enfant ou non, pourra être, lui aussi, grâce à elles, hébergé par la structure. Ces femmes protègent les autres, dirigent leur vie, savent où elles vont, pourquoi elles le font, avec qui. Cela ne signifie pas qu’elles ne vivent pas de violences sexuelles, mais avoir cela présent à l’esprit aide aussi à identifier et à dénoncer les réels réseaux de traite, qui sont très discrets. Cette image de femme victime absolue ne rend service à personne.
KK : Peut-on dire alors dire que cette misogynie de la représentation autorise sur le terrain, et par contraste, une forme de misandrie doublée de racisme ?
MC : Les personnes migrantes que l’on voit le plus sont les hommes âgés entre 16 et 30 ans, parce que moins facilement protégés ; et ceux-là sont confrontés à des impensés postcoloniaux racistes. Le traitement de l’accueil, ici à la frontière franco-espagnole (mais pas uniquement), est très différent suivant que les jeunes arrivants soient arabes ou subsahariens. Les hommes noirs peuvent être érotisés, entre autres types de racisme — et cela peut aller très loin : un jeune homme a porté plainte pour viol contre une femme l’ayant accueilli, dans une commune proche —, mais surtout, ils ne sont pas inquiétants. En revanche, les jeunes Algériens ou Marocains se retrouvent souvent seuls, à la rue. L’attention que l’on accorde aux jeunes Arabes, même dans les milieux associatifs et militants, est encore profondément déterminée par les incidents de 2018 survenus dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, où des mineurs marocains isolés ont semé le trouble. Si bien que certain·e·s militant·e·s ne peuvent s’empêcher de considérer tout jeune Marocain à travers le filtre de ce précédent, qui a été surmédiatisé et même sur-commenté sociologiquement. Mais la route des Canaries s’étant ouverte depuis, on sait qu’il y a beaucoup plus de Marocains qui y transitent que de Subsahariens, tandis que les Algériens prennent la route tunisienne. Alors où sont-ils, les jeunes Arabes ? Les Algériens, par exemple, sont le plus souvent dans leurs communautés, aidantes et accueillantes, et cela conforte nombre de militant·e·s dans leur désintéressement, tout à fait inconscient bien sûr : au contraire des Subsahariens, les Algériens arriveraient avec des réseaux, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde arrive plus ou moins grâce à un réseau organisé, c’est à dire en bénéficiant d’aide, quand les frontières sont fermées et leur passage criminalisé par les politiques européennes. Il n’est pas rare en effet (et pas très surprenant) que les jeunes Algériens connaissent en France quelqu’un, installé depuis longtemps, qui leur propose du travail, forcément illégal. Est-ce cela qu’autorités et militant·e·s appellent « des réseaux » ? Ce problème de racisme est à la base du silence qui a failli entourer l’accident de train de Ciboure
/02
/02
https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog/231021/victimes-de-la-front…
: le préjugé de la délinquance, qui a risqué de disqualifier les jeunes hommes victimes — les trois morts et celui qui a survécu — de la possibilité d’une justice.
KK : La mort est l’un des multiples fils rouges de ton livre. Tu pistes souvent la trace d’une personne disparue, dont on va découvrir qu’elle est morte, que l’on imagine comme telle, ou dont il faut rapatrier ou inhumer le corps suivant des procédures administratives très lourdes. En te lisant, on a le sentiment que le traitement médiatique de la mort dans les parcours migratoires donne souvent ces personnes pour perdues, qu’elles soient décédées ou vivantes.
MC : Huit jeunes gens sont morts, en quelques mois, ici, à la frontière. Le 20 novembre dernier, on a repêché un corps dans le fleuve Bidassoa, que la famille et des ami·e·s ont pu identifier, suivant un réseau de preuves, comme étant celui de Sohaibou Billa. Il était ivoirien. Pour inhumer le corps, il faut qu’après l’enquête de la police, la juge valide l’identification. Celle-ci refuse de le faire, par absence de preuves scientifiques. Les empreintes ne concordent avec aucune des données collectées en Espagne, ce qui est normal : le jeune homme était entré par l’Italie. La juge, après deux mois, refuse toujours de demander que les empreintes soient cherchées dans le fichier EURODAC ou que l’on prélève de l’ADN sur la dépouille, les fameuses preuves scientifiques. Les choses pressent, il faut enterrer ce corps, la famille nous en supplie. Sohaibou Billa sera enterré sans certificat de décès à son nom. Anonymement. Dans un pays où on ouvre encore les fosses communes pour rendre leurs noms aux victimes du franquisme. Voilà ce qu’il est, ce corps, pour plusieurs : celui d’un garçon sans papiers, que personne n’attend. On continue de penser que les personnes qui migrent sont désaffiliées. Les gens n’arrivent jamais seuls, et croire qu’ils le sont, c’est poser une limite à la reconnaissance des droits d’une personne morte et du devoir qui, à ce titre, nous incombe envers les vivant·e·s.
KK : Ta manière de retranscrire les récits des migrant·e·s que tu croises laisse suggérer que tu recherches une forme de vérité qui n’est pas celle du fait, mais la leur propre, intime, qui tranche souvent avec l’injonction à la factualité à laquelle iels sont soumis·e·s une fois arrivé·e·s en Europe, notamment lors de la demande d’asile.

MC : Il y a l’histoire de ce garçon dans un bateau perdu qui, soudain, aux abords de Lampedusa, entend des chants de femmes. Je demande : « Les femmes du bateau ? » « Mais non, me répond-il, des femmes de loin. » Je demande si c’est vrai, il me répond qu’un nourrisson a pleuré au même moment, ce qui veut dire qu’il a aussi entendu le chant — c’est donc vrai. Je veux dire : c’est la vérité. Un nourrisson a pleuré, il a entendu le chant. On n’en demande pas plus. Puis les Camerounaises du bateau se sont mises à entonner des chants en harmonie. C’était le signe du salut : on allait accoster. Dans mon livre, on voit apparaître, sous les traits d’un autre garçon que je rencontre, le petit Hermès, et ce n’est pas le discréditer, lui qui est en train de me parler au café, que de le comparer au dieu messager. Mais même si la tentation est grande, il y a un problème à vouloir à tout prix doter les personnes rencontrées d’un récit mythique plus grand qu’elles ; ce récit peut devenir un fardeau. Un autre garçon raconte le moment où, travaillant sur un chantier en Libye, il accompagne son patron pour acheter une kalachnikov. Ce dernier fait semblant de l’essayer sur lui. Tout d’un coup, le garçon se retrouve dans une fiction et il assiste à son propre dédoublement, entre le garçon qui regardait des fictions la veille encore et celui qui, d’un coup, les vit.
KK : Toujours suivant ce protocole de vérité — qui est celui des personnes migrantes, c’est-à-dire peu ou prou compatible avec les biais ethnocentristes du rationalisme —, et alors même que l’on te raconte des histoires souvent surréalistes, tu résistes à la fiction. Comment vis-tu cette lutte avec l’imaginaire ?
MC : J’aime l’impossible, que l’histoire ne s’arrête jamais, que l’on puisse la faire décoller. Cependant, le récit que l’on est à soi-même, lorsque l’on est en situation d’exil, est d’un tel enjeu qu’il est impossible pour moi d’y apposer la moindre fiction. Alors j’essaie de résister au plaisir de la fiction pour être la plus précise possible. Par exemple, lorsque je tente de reconstituer la trajectoire d’une personne qui a disparu, je ne peux comprendre et faire comprendre les choses qu’en faisant le pari de l’extrême détail. Et le détail n’est pas forcément attrayant, il peut même être très technique, ennuyeux, mais l’on est obligée de se le coltiner pour comprendre, car c’est sur lui que repose la compréhension de l’ensemble. Dès lors, la question de faire fiction ne se pose même pas.
KK : La crise migratoire est sans doute la plus grande tragédie humaine de ce début de siècle. Peut-on alors considérer que ta méfiance envers la fiction s’apparente à une nouvelle « ère du soupçon » ?
MC : Je ne fais pas de manifeste, il y a plusieurs façons de faire des choses très valables avec ce qui se passe actuellement en Méditerranée et dans l’Atlantique. Néanmoins, pour ma part, je ne peux pas produire de l’art avec cela. Je prends des notes très rapides, presque sans me retourner, ce qui change singulièrement le rapport à l’écriture. L’on a moins le temps de s’attarder sur l’esthétique — cela n’a plus d’importance. C’est comme si l’on écrivait les archives du présent pour le futur. Le 23 janvier dernier, on a vu disparaître un bateau quasiment sous nos yeux ; Salvamento, la société de sauvetage maritime espagnole, est allée le chercher et a rebroussé chemin — on ne sait toujours pas pourquoi. Sur 55 passagers, 10 ont survécu, et c’est arrivé devant nous. Comment peut-on le soir regarder son texte et se demander s’il est bon ? On est juste en train de tenir registre, parce qu’il ne faut rien oublier, parce que chaque détail compte. C’est la précision qui fera qu’un jour on comprendra ce qui s’est passé là, cette tragédie que l’on attendait et qui est en train de se dérouler, ici et maintenant.
KK : Plusieurs récits de rêve personnels ponctuent ton livre comme autant de points-relais. Quel rôle ton activité onirique a-t-elle joué au sein de tes enquêtes et du processus d’écriture ?
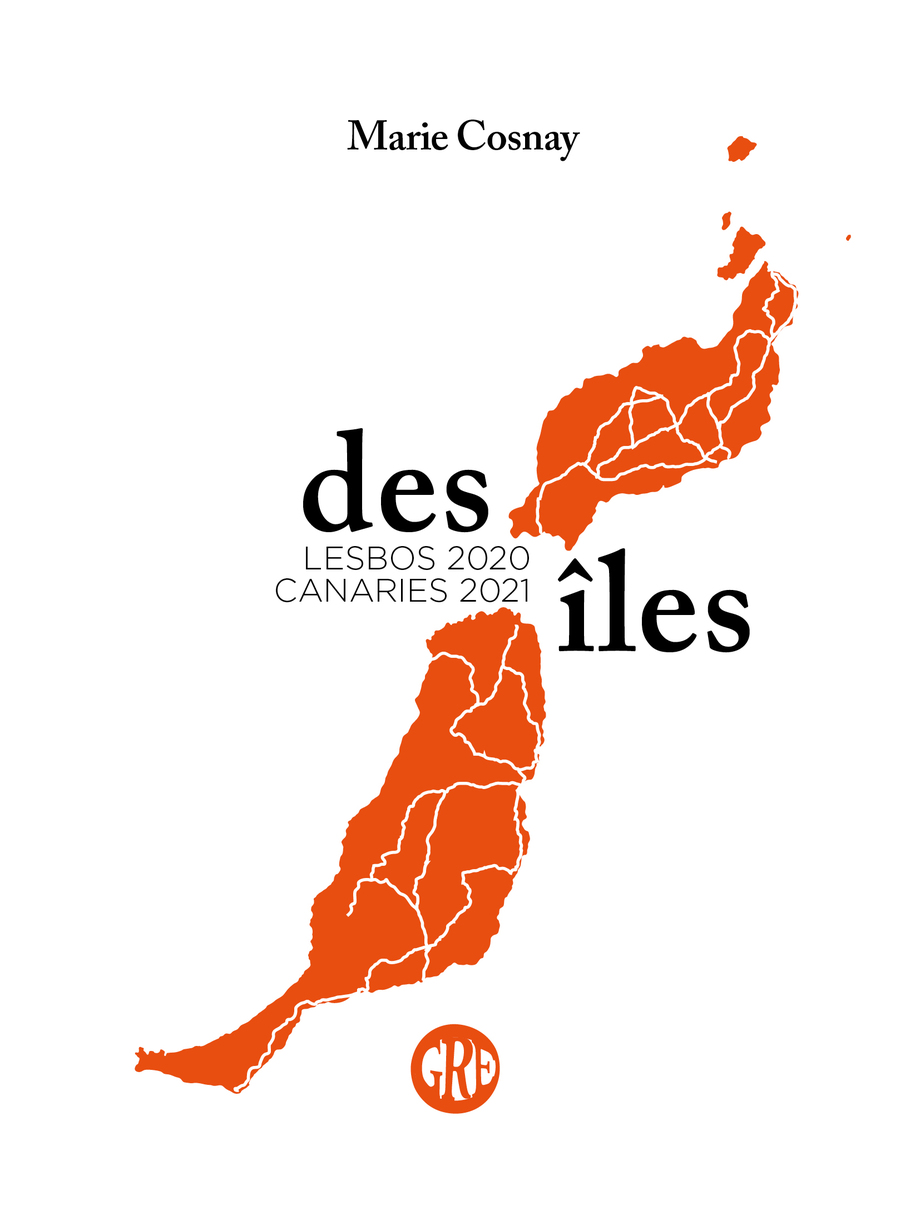
MC : Durant la période où je menais ces enquêtes et les retranscrivais, j’ai beaucoup rêvé, souvent d’enfants morts. En les écrivant, je comprendrais ce que ces rêves-là venaient me dire ceci : que ces questions de migration, collectives, me mettaient moi-même en question, en route et en œuvre, parce qu’elles rejoignaient une question intime et personnelle. Dans ma volonté d’écrire au service de, se cache évidemment le « je », l’ego, le petit. Mais cela, personne n’a besoin de le savoir, il me suffit que ce soit écrit. J’ai supprimé la moitié de ces récits de rêve, en aucun cas cela m’importait qu’ils soient lus. Je n’ai voulu en garder que la trace.
KK : Des Îles fourmille de personnages, de noms, de voix qui, à un moment donné, s’entremêlent, notamment avec la tienne propre, que l’on entend si peu par ailleurs. Alors même qu’il te tient à cœur de restituer voix et noms à celleux qui parlent. À quoi tient un tel paradoxe ?
MC : C’est l’impersonnel, l’intersection. C’est le « je », le « tu » et à la fois quelqu’un d’autre : tout réside dans ce paradoxe. La personne dont je parle n’est jamais réductible à ce que je dis d’elle, ni à ce qu’elle dit d’elle-même, ni à la traversée qu’on sait qu’elle a faite. Il faut être très précis·e sur ce qui entoure la personne dont on parle tout en acceptant que la figure qui s’en esquisse ne soit pas saisissable. Il y a par exemple cette jeune mère, D., que j’admire énormément. Nous nous comprenons mutuellement d’une manière très rare et forte sans jamais nous poser la moindre question d’ordre personnel. Tout ce qui m’importe, c’est cette volonté incroyable qu’elle a eue, il y a quatre ou cinq ans, lorsqu’elle a décidé de rejoindre son conjoint en Europe. Elle a tout mis en œuvre, et ce n’était pas sans pertes, sans douleurs ou traumatismes, mais à 35 ans, son projet est accompli : elle a rapatrié tous ses enfants et maintenant la famille est en France. C’est là tout ce qui m’importe d’elle, et à mon avis, c’est une façon magnifique de connaître quelqu’un. Il s’agit en fait d’éviter de circonscrire une personne, de la capturer dans une figure quelconque : celle de la victime, immensément vulnérable, ou celle du héros auréolé de toute sa gloire. Ces personnes bougent, migrent, mais elles se déplacent aussi hors des cadres. Les cadres et les figures contraignent, mettent sous silence, alors qu’il y a une possibilité immense de partager des expériences.
crédits photos : Mélanie Gribinski