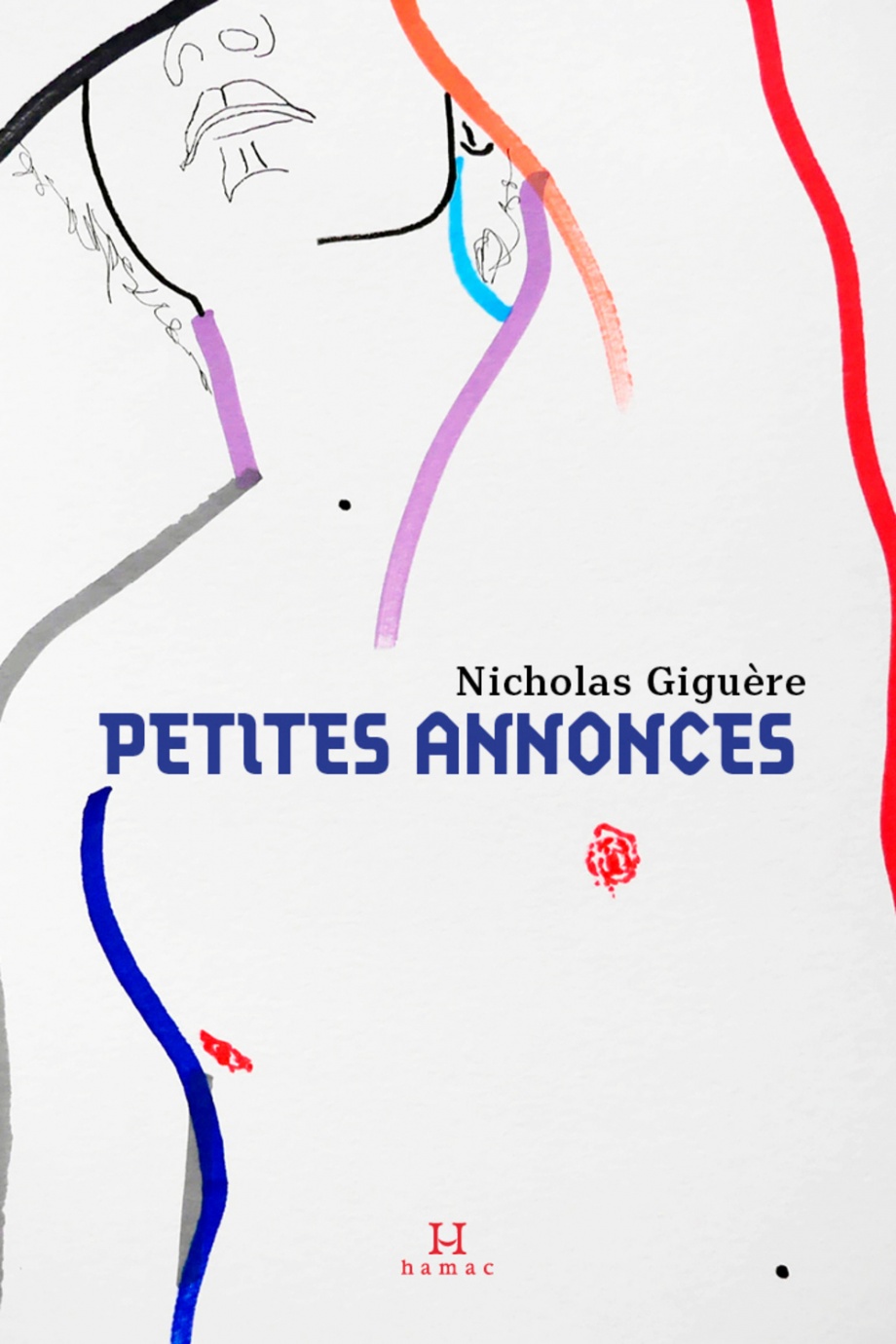Jusqu’au déclin, Patrice Laliberté, Netflix, 2020.
///
Si la porte n’a pas de clé
C’est qu’il n’y a rien à voler
Sous le toit de ma cabane au Canada
— Loulou Gasté, « Ma cabane au Canada » (Interprétation : Line Renaud)
Arriver à point
Bien malin celui ou celle qui, par les temps qui courent, voudrait commencer une critique de Jusqu’au déclin (Patrice Laliberté, 2020) sans faire écho à l’actualité.
Depuis environ un an, on sait en effet que Jusqu’au déclin devait être le premier film québécois produit pour Netflix. On connaissait aussi les grandes lignes de son récit : à l’ère de l’engouement médiatique pour les catastrophes (sanitaires, écologiques, sociales, technologiques) qui menacent l’équilibre du monde capitaliste contemporain, un groupe de zélés (Guillaume Laurin, Marie-Ève Lessard, Marc-Antoine Grondin, Marc Beaupré, Marylin Castonguay, Guillaume Cyr) mené par un gourou charismatique (Réal Bossé) se terre dans les bois pour une expérience « survivaliste », afin d’être prêt une fois que le grand désastre arrivera. « Le calme qu’on connaît d’habitude, il ne tient pas à grand-chose », annonce prophétiquement notre gourou.

Tout ça, donc, nous le savions. Mais ce que tout le monde ignorait, c’est qu’au moment d’écrire ces lignes, la moitié de l’humanité – soit plus de 3,8 milliards de personnes dans plus de 80 pays – serait en confinement en raison d’une crise sanitaire sans précédent depuis la grippe espagnole qui, en son temps, avait décimé entre 2,5 et 5% de l’ensemble de la population mondiale, comme nous le rappelle Wikipédia. À l’époque, toutefois, il n’y avait pas Wikipédia et il n’y avait pas Netflix.
L’époque est le message
Comment ne pas être subjugué par la prescience historique fabuleuse – mais bien involontaire – dont semble avoir été doté ce thriller apparemment sans conséquence, au scénario cousu de fils blancs ? Indépendamment des possibles qualités esthétiques du film, Jusqu’au déclin est un exemple probant de l’influence des schèmes historiques et les paradigmes qui, au-delà de la singularité des créateurs (en tant que personnes individuelles), sont les vrais producteurs des œuvres.

Dans son ouvrage de 1964 Pour comprendre les médias, le philosophe canadien Marshall McLuhan écrivait la formule, devenue célébrissime, « Le message, c’est le médium » (« The medium is the message »). Par là, il fallait comprendre que le dispositif technologique et matériel à la base de l’œuvre structure sa vision du monde autant, sinon plus, que la lettre de son histoire (personnages, péripéties, etc.). Indépendamment de ce qui est raconté, il y a une manière de penser et de créer propre au cinéma, à la littérature, à la musique, etc. Aujourd’hui, cette théorie n’est plus suffisante et, à l’instar de Jean-Marc Larrue et Marcello Vitali Rosati – coauteurs du récent Media Do Not Exist: Performativity and Mediating Conjunctures –, il vaut encore mieux parler de « conjonctures médiatrices », c’est-à-dire l’ensemble mouvant des plateformes, des luttes entre médias officiels et médias alternatifs, des innovations technologiques et strates de discours qui, avant même que nous ayons commencé à écrire ou à filmer, ont déjà commencé à produire l’œuvre. L’époque est déjà une fiction et c’est d’abord elle qu’il faut tenter de comprendre.
Fictions du seuil : de l’actualité au mythe
C’est bien la grande force de Patrice Laliberté et de son équipe que d’avoir choisi de porter leur attention sur le point de basculement entre information et fiction. À travers l’histoire d’Antoine, père de famille anxieux qui suit avidement les vidéos YouTube d’Alain, maître survivaliste amateur, Jusqu’au déclin prend le pouls de l’époque : la fin du monde est proche, il faut se préparer. Ce message ne vient pas des grands médias d’information, car trop froids et impersonnels, mais des réseaux alternatifs où le contenu est produit « à la mitaine » par des citoyens plongés dans le flux de l’Histoire qui, d’hurluberlus sympathiques, deviennent des visionnaires. Nos existences quotidiennes se déroulent au seuil d’un précipice, et il ne faut qu’un faux pas pour y basculer.

Jusqu’au déclin est un film sur les limites : limite entre la survie et la folie, entre la communauté et l’individualisme, entre la fiction et la réalité, entre la permanence et le changement. Méthodiquement, par les outils (plus ou moins affinés) du thriller survivaliste, il explore cette question : que sommes-nous prêts à faire pour ne pas franchir un seuil ? Pour Alain, la réponse est claire : « C’est juste une question de temps avant que tout se mette à chier. Quand ça va arriver, moi je ne veux pas que mon monde change », confie-t-il à Antoine, en qui il voit quelqu’un capable de prolonger son œuvre de microsociété idéale.

Un accident – thème central du cinéma québécois contemporain (notamment chez Sophie Deraspe avec Les signes vitaux [2010], Sébastien Pilote avec Le vendeur [2011], Guy Édoin avec Marécages [2011] et Rafaël Ouellet avec Camion [2012]) – fera tout basculer : François, l’un des élèves d’Alain, se voit mortellement blessé lors d’un exercice de survie (c’est l’ironie du sort…). Vient alors le temps des décisions : faut-il appeler la police, quitte à mettre en péril la « base autonome durable et survivaliste » que le maître a pris plus de dix ans à peaufiner ? Les barbares peuvent-ils envahir la cité ? Alain sera catégorique : « Si on appelle quelqu’un de l’extérieur, c’est fini ». Des clans vont donc se former entre, d’une part, ceux qui sont prêts à traverser le seuil pour laisser la loi prendre en charge cette situation critique et, d’autre part, ceux qui vont se battre pour que rien ne change, malgré la crise.
Des hantises contemporaines, on retrouve donc un schéma immémorial, propre à l’espace nord-américain : celui de la frontière entre la civilisation et la sauvagerie, l’ordre et le chaos. Film sur l’actualité, Jusqu’au déclin est aussi, d’abord, un récit qui trouve ses racines dans les mythes westerns et canadiens-français – de Maria Chapdelaine (1914) à The Revenant (2015) – alliant frontière, altérité et découverte de soi. L’intérêt de cette manifestation-ci de ces mythes est d’être à ce point nervurée par les angoisses et les crises du présent. « Au pays de Québec, rien ne doit mourir et rien ne doit changer », écrivait déjà Louis Hémon.
Traverser l’écran ?
On peut conclure cette critique par la plus belle scène du film. « Les épiceries dans une ville comme Montréal sont approvisionnées aux trois jours. Ça veut dire qu’au bout de trois jours, si les camions ne sont pas repassés, y’a pu rien sur les tablettes, le monde crève de faim, c’est le chaos et tout le monde se bat. » Ces phrases, évidemment, sont prononcées par Alain. Dans son atelier, il donne des trucs maison pour la préservation de la nourriture. Ses gestes sont précis, soignés. Malgré la nature alarmiste de ses propos, son ton est rassurant. Dans un travelling arrière tout aussi doux, on découvre que nous ne sommes pas réellement avec Alain, mais qu’il s’agissait d’une vidéo, qui est en train de jouer sur un ordinateur portable posé sur une table.

Nous sommes en fait dans la cuisine d’Antoine. Avec sa fille comme assistante, il imite les gestes du maître survivaliste afin de sceller son propre 20 kilos de riz. En arrière-plan, celle qu’on devine être la maman boit son café et replace les coussins de son divan. Il y a une tension entre les gestes de la survie et ceux du quotidien. Cette tension est redoublée lorsque la fille d’Antoine énumère les catastrophes qui pourraient éventuellement mener à l’ouverture de ce sac maintenant scellé. « Si y’a une crise économique ou si la planète se réchauffe encore plus, les gens vont avoir faim pis nous on va être prêts », dit-elle tout sourire, comme s’il s’agissait d’un jeu. Contrairement aux séquences plus dramatiques du film, où aucun effet n’est ménagé pour capter l’attention première du téléspectateur, cette scène offre une composition plus subtile où s’installe un jeu sur les limites de la croyance et de l’imitation.
Le travelling arrière dévoilant l’ordinateur posé sur la table est un premier outil dialectique : Alain n’est qu’une image, un produit de l’écran. Ce serait une première raison de ne pas croire ses propos : il incarne une curiosité médiatique, une excentricité. Mais voilà que, alors que la caméra traverse de la réalité fictionnelle d’Alain à celle du quotidien des personnages, les gestes issus de l’image sont recopiés à l’identique dans le monde réel, par une famille qui semble tout sauf paranoïaque ou au bord de la crise de nerfs. À ce moment, le film ne juge pas les actions des personnes et n’amène pas de morale (ce sera de moins en moins vrai alors que l’étau du drame se resserre).
Le spectateur est laissé à lui-même pour interpréter cette scène : peut-on vraiment juger cette petite famille ? ses membres sont-ils les victimes d’une propagande médiatique ? À l’évidence non, car ils ne font qu’éprouver notre ancestral besoin de croyance, d’imitation et de communauté. Nous vivons entourés de fictions qui n’attendent qu’un signe pour traverser le seuil et, par nos gestes, devenir réalité. Jamais les personnages du film ne sont aussi vrais que dans cette scène, dans leur maladresse et leur humanité, où l’on voit plus que jamais l’horizon proprement documentaire de tout récit. Et si nous reculions encore la caméra, que verrions-nous dans la maison de tous ceux et celles qui, en quarantaine, sont en train de visionner Jusqu’au déclin ?